
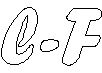

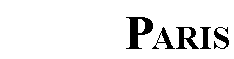
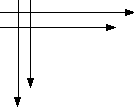
Les constructions majestueuses se poursuivirent sous l'autorité de Colbert, qui fit appel à de grands architectes (François Mansart, Claude Perrault) : achèvement du Louvre (colonnades de Perrault), création de l'Observatoire, hôtel des Invalides, hôpital de la Salpêtrière, place Louis-le-Grand (actuelle place Vendôme), place du Carrousel, jardin des Tuileries, manufacture des Gobelins, portes monumentales (arcs de triomphe des portes Saint-Denis et Saint-Martin). Ce faste architectural contrastait fortement avec le Paris des travailleurs, surpeuplé, misérable (disettes) et dangereux. Une charge de lieutenant de police fut créée en 1667. L'éclairage public des rues la nuit fut instauré. Le contraste entre ces deux Paris s'accentua sous la Régence et sous Louis XV. Celui-ci fit construire la vaste place de la Concorde (ancienne place Louis-XV) et la perspective des Champs-Élysées. L'architecte Germain Soufflot édifia l'église Sainte-Geneviève (Panthéon). La fièvre des affaires, le développement des banques, de la finance et du négoce entraînèrent une forte spéculation immobilière, avec la construction de beaux immeubles et de magnifiques hôtels particuliers (hôtel Crillon). L'expansion urbaine de Paris se poursuivit vers le nord (quartier de la Chaussée-d'Antin) et vers l'ouest. En 1789, la ville comptait plus de 600 000 habitants. Le rayonnement de Paris, capitale intellectuelle et culturelle de l'Europe, atteignit son apogée au XVIIIe siècle. La vie littéraire et artistique se développait dans les églises (musique baroque), dans les théâtres (Odéon, future Comédie-Française), dans les salons (Mme de Tencin, Mme Geoffrin, Mme de Lambert) et dans les cafés qui se multiplièrent (Le Procope). Les idées des encyclopédistes y connurent une grande diffusion. La crise économique et sociale, la cherté de la vie provoquèrent à Paris des émeutes prérévolutionnaires (faubourg Saint-Antoine, 28 avril 1789). Tandis que les États généraux, réunis à Versailles en mai-juin 1789, procédaient à une révolution bourgeoise et pacifique, substituant à la monarchie absolue une monarchie constitutionnelle, Paris, confrontée à la disette, s'engagea dans une révolution violente et créa sa propre milice. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, permit à la population de s'armer. À la suite d'un incident («!banquet des gardes du corps!»), la foule parisienne en colère se porta à Versailles pour ramener le roi et sa famille à Paris. Mais la fuite du roi (20 juin 1791) puis la fusillade du Champ-de-Mars (17 juillet 1791) marquèrent la rupture de la capitale et du roi. Le mouvement révolutionnaire s'accentua tandis que les milieux populaires étaient gagnés par un état d'esprit égalitaire, impulsif et violent («!sans-culottisme!»). Il déboucha sur l'instauration de la Ire République et de la Terreur (voir Révolution française). Pendant la Révolution et sous Napoléon Ier, la suprématie de Paris sur le reste du pays s'accrut. Une politique de grands travaux fut entreprise par Napoléon, qui rêvait de faire de Paris le miroir de la France et la capitale de l'Europe : agrandissement du Louvre, Arc de Triomphe, colonne Vendôme, achèvement du Panthéon, église de la Madeleine. D'importants aménagements furent apportés en matière d'équipements publics : réseaux d'égouts, ponts, quais, hôpitaux, création d'abattoirs et de marchés (halles au blé et au vin), construction du canal de l'Ourcq. L'embellissement et l'équipement de Paris se poursuivirent tout au long du XIXe siècle (Restauration, monarchie de Juillet, second Empire). Parallèlement, la ville demeura politiquement agitée et fut le théâtre de plusieurs insurrections (révolution de juillet 1830, de février 1848, Commune de Paris de 1871), tandis que s'effectuait sa grande mutation sociale et économique (révolution industrielle et des transports, immigration massive). Une population trop nombreuse d'artisans pauvres, de petits boutiquiers et d'ouvriers commença à s'entasser à l'est de la capitale. Les limites urbaines ayant reculé, le chef du gouvernement Louis Adolphe Thiers ordonna en 1844 la réalisation d'une nouvelle enceinte, à l'emplacement de l'actuel Boulevard périphérique. La centralisation politique, administrative, économique et culturelle en faveur de la capitale fut renforcée sous le second Empire. L'empereur Napoléon III avait de hautes ambitions pour Paris et, à partir de 1852, avec le préfet de la Seine, le baron Georges Haussmann, imposa à la ville une partie de sa physionomie actuelle. Elle fut remodelée à la fois dans un souci d'urbanisme et de maintien de l'ordre public. Entouré de nombreux ingénieurs dont Jean-Charles Alphand, Haussmann entreprit de grands travaux d'embellissement, d'assainissement et d'équipements modernes de la capitale : nouveaux égouts, réservoirs, éclairage au gaz, aménagements des espaces verts (parc des Buttes-Chaumont au nord et parc Montsouris au sud, conçus sur le site d'anciennes carrières, jardins du bois de Boulogne à l'ouest et du bois de Vincennes au sud-est), agrandissement des gares et création de la «!Petite Ceinture!» (ceinture de chemin de fer périphérique), construction de nouveaux ponts, d'hôpitaux (Lariboisière, Sainte-Anne), du Théâtre de l'Opéra (par Charles Garnier), de la place de l'Étoile (aujourd'hui place Charles-de-Gaulle). Le centre de la capitale fut percé de grandes avenues rectilignes, bordées d'immeubles cossus et bourgeois : axe méridien (boulevard Saint-Michel, boulevard de Sébastopol), axe transversal (rue de Rivoli, avenue Daumesnil), Grands Boulevards, boulevard Saint-Germain. Les grandes Halles centrales furent réaménagées, avec la création des pavillons de Victor Baltard. L'essor industriel de la ville s'accompagna d'une véritable explosion démographique (1,8 million d'habitants en 1871). Le refoulement de la population ouvrière vers les quartiers périphériques orientaux, déjà surpeuplés, accentua encore le déséquilibre social entre l'est et l'ouest de la capitale. La chute du second Empire (4 septembre 1870), la guerre franco-prussienne de 1870-1871 (siège de Paris, septembre 1870-janvier 1871!; capitulation de Paris, 28 janvier 1871) et le transfert de l'Assemblée et du gouvernement Thiers à Versailles provoquèrent une nouvelle révolution parisienne, soutenue par l'Association internationale des travailleurs, la Commune de Paris (mars à mai 1871). Les communards brûlèrent une grande partie du centre de la ville et 20 000 Parisiens furent tués en défendant la ville contre les troupes de la IIIe République (les «!versaillais!»). La Commune fut la dernière grande insurrection parisienne. Paris connut, sous la IIIe République, une forte prospérité économique, marquée par les Expositions universelles de 1878, de 1889 (construction de la tour Eiffel), et de 1900 (construction du Grand et du Petit Palais, du pont Alexandre-III et du premier métropolitain). Au sommet de la butte Montmartre fut construite la basilique du Sacré-Cœur (1876-1910), et des quartiers nouveaux s'étendirent à l'ouest (Trocadéro, Passy, Auteuil). Alimentée par un exode rural massif, la population parisienne comptait plus de 2,5 millions d'habitants en 1896. La ville connut à nouveau un extraordinaire foisonnement culturel et artistique, sur le plan littéraire (Émile Zola, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Pierre Reverdy, etc.) et surtout sur le plan de la peinture avec les impressionnistes (Monet, Renoir, Pissarro), puis, au début du XXe siècle, avec les peintres du Bateau-Lavoir et Henri de Toulouse-Lautrec à Montmartre. 1"Paris", Encyclopédie® Microsoft® Encarta 98. © 1993-1997 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. |
||
|
Économie |
||