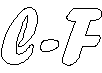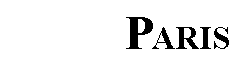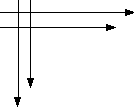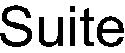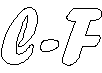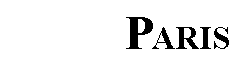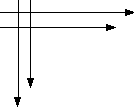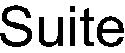|
Histoire
Le village gaulois et la cité gallo-romaine
Vers le milieu du IIIe siècle av. J.-C., les Celtes de la tribu des Parisii s'installèrent dans l'île de la Cité, la fortifièrent et l'appelèrent Lutetia (Lutèce). En 52 av. J.-C., Lutèce tomba aux mains des Romains. Elle prit le nom de Civitas Parisiorum (Paris) et commença à s'étendre sur la rive gauche de la Seine. Les principaux vestiges de cette époque sont aujourd'hui les thermes de Cluny et les arènes de Lutèce (IIIe siècle apr. J.-C.). Le christianisme fut introduit par saint Denis, premier évêque de la ville, qui fut décapité par les Romains en 280. À partir du IVe siècle, les invasions barbares obligèrent les habitants à se réfugier sur l'île pour mieux se défendre. En 451, menacés par les Huns d'Attila, les Parisiens résistèrent grâce à l'intervention de sainte Geneviève qui devint la patronne de la ville.
La capitale du royaume
En 486, Clovis Ier s'empara de Paris et en fit, au début du VIe siècle, la capitale du royaume franc. La ville prit un nouvel essor et se développa sur les deux rives de la Seine. Le christianisme s'épanouissant, Paris connut alors une période d'intense rayonnement religieux, avec la construction d'abbayes et de prieurés (Saint-Germain-l'Auxerrois). Mais la ville fut délaissée par les derniers Mérovingiens puis par les Carolingiens, Charlemagne ayant choisi comme capitale Aix-la-Chapelle. Au cours du IXe siècle, Paris dut lutter contre les invasions des Vikings, et la cité fut soumise à un long siège en 885-886. Les Parisiens repoussèrent les assaillants sous la conduite du comte Eudes et de l'évêque Gozlin.
À l'avènement de la dynastie capétienne en 987, Paris devint la capitale du royaume de France et connut un rapide essor politique, économique et urbain. Pour protéger la ville, Philippe Auguste fit édifier une puissante muraille de pierre (1180-1223), renforcée par la forteresse du Louvre (1204) et par la tour de Nesle. Les rues furent pavées, et le marché des Halles fut créé en 1183. Des ponts (Petit-Pont, Pont-au-Change) relièrent l'île de la Cité à la rive droite commerçante et à la rive gauche, lieu de fondation de l'Université (1215). La construction, sur l'île de la Cité, de la cathédrale Notre-Dame (entreprise en 1163 par l'évêque Maurice de Sully) puis celle de la Sainte-Chapelle (1246-1248) sous Saint Louis et enfin l'agrandissement du Palais royal sous Philippe le Bel (1285-1314) contribuèrent à faire de la Cité le cœur politique et religieux du royaume de France.
Autorité et rayonnement
Les trois parties du Paris médiéval (la Cité, la rive droite commerçante et la rive gauche universitaire) s'étendirent et gagnèrent en importance. Deux autorités, souvent rivales, s'établirent. Un prévôt du roi, installé au Châtelet, dirigeait la ville à la place du monarque. Un prévôt des marchands, résidant à l'Hôtel de Ville, était responsable des marchés pour les corporations. En 1257, Robert de Sorbon, confesseur de Saint Louis, reçut l'autorisation de créer un collège, la Sorbonne. Des étudiants affluèrent de tous les pays et l'université de Paris devint l'un des grands centres intellectuels (théologie, philosophie) de la chrétienté médiévale. Ses grands maîtres furent notamment Bonaventure, Thomas d'Aquin ou encore Jean de Gerson. Avec près de 100 000 habitants, Paris devint, au XIIIe siècle, la plus grande ville de l'Europe chrétienne.
La guerre de Cent Ans et les révoltes
Au XIVe siècle, Charles V (1364-1380) construisit une nouvelle enceinte afin de protéger les nouveaux faubourgs contre les Anglais. Elle était défendue à l'ouest et à l'est par les forteresses du Louvre et de la Bastille. Paris connut une période sombre. Les troubles de la guerre de Cent Ans, succédant à la peste noire de 1348-1349, affaiblirent l'autorité royale et renforcèrent le pouvoir municipal. Dans un climat de marasme économique, Paris devint un foyer d'agitation révolutionnaire.
Les Parisiens se révoltèrent à plusieurs reprises contre le roi : insurrection d'Étienne Marcel contre le Dauphin (1356-1358), révolte des Maillotins (1382) et de Caboche (1413). La ville prit ouvertement parti pour les Bourguignons contre les Armagnacs (massacrés par la population parisienne en 1418) et le roi. L'Université reconnut même le traité de Troyes (21 mai 1420) qui faisait du roi d'Angleterre Henri VI le nouveau souverain français. Paris pactisa avec les Anglais, qui prirent le contrôle de la ville de 1422 à 1439, malgré le siège de Jeanne d'Arc en 1429.
Roi légitime, Charles VII reprit possession de Paris en 1436. La paix et la prospérité furent restaurées dans la seconde moitié du XVe siècle, dans un royaume à nouveau unifié. Les constructions reprirent, parmi lesquelles les hôtels de Sens et de Cluny, qui furent les dernières productions de l'art médiéval. Toutefois, longtemps suspecte, Paris ne retrouva son rôle de capitale que sous François Ier (1515-1547).
Renaissance et guerres de Religion
Les Valois furent des bâtisseurs : nouvel Hôtel de Ville, église Saint-Eustache, palais des Tuileries, Pont-Neuf. Le vieux Louvre de Philippe Auguste laissa la place à des bâtiments Renaissance. Ouverte aux idées de la Renaissance, la ville connut à nouveau un grand rayonnement intellectuel et culturel : essor de l'imprimerie et de l'humanisme, fondation du Collège de France par Guillaume Budé, nombreux savants (Ambroise Paré, Bernard Palissy), poètes de la Pléiade (Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay).
Bastion catholique, Paris fut foncièrement hostile à la Réforme. Les passions se déchaînèrent rapidement et de violents conflits religieux éclatèrent, à partir de 1534, entre les catholiques et les protestants. Les guerres de Religion culminèrent avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, au cours duquel des milliers de huguenots furent assassinés. Lors de la «!journée des barricades!» (12 mai 1588), organisée par la Ligue et son chef Henri de Guise, le roi Henri III dut s'enfuir. L'assassinat du duc de Guise, en décembre 1588, provoqua un nouveau soulèvement dans la capitale, qui fut assiégée par Henri III. Défendue par le duc de Mayenne, elle connut alors une grave famine (1589). Henri III s'apprêtait à s'emparer de Paris lorsqu'il fut assassiné par un moine ligueur fanatique, Jacques Clément (août 1589). La paix ne fut restaurée qu'en 1594, après l'abjuration et l'entrée à Paris du nouveau roi Bourbon, Henri IV.
Les chantiers d'Henri IV
Paris reprit son expansion économique et urbaine sous le règne des Bourbons. La capitale fut embellie par de nouvelles réalisations. Sous Henri IV furent construits la place Royale (actuelle place des Vosges), la place Dauphine, les quais de l'Arsenal, de l'Horloge et des Orfèvres. Le Pont-Neuf fut achevé. Les constructions s'accélérèrent sous la monarchie absolue et centralisatrice : édification du palais du Luxembourg par Marie de Médicis, construction du Palais-Cardinal (Palais-Royal) par Richelieu, du Val-de-Grâce par Anne d'Autriche. La capitale s'agrandit sous Louis XIII. Le développement de nouveaux quartiers (Marais, faubourg Saint-Honoré, Bastille, faubourg Saint-Germain) entraîna l'édification d'une nouvelle enceinte (actuels Grands Boulevards). L'île Saint-Louis fit l'objet d'un vaste aménagement (hôtel Lambert, hôtel Lauzun). Le rayonnement culturel de la capitale se renforça avec la création de l'Imprimerie royale en 1620, du Jardin des Plantes en 1626 et de l'Académie française en 1635 (voir Institut de France).
______________________________
1"Paris", Encyclopédie® Microsoft® Encarta 98. © 1993-1997 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
|
|